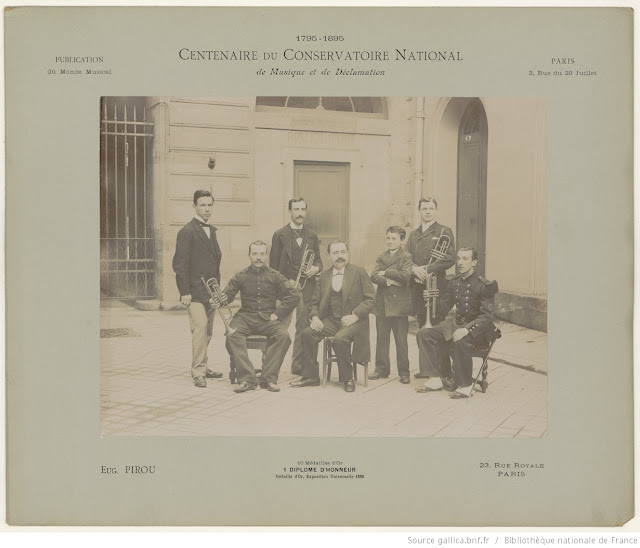Parmi mon corpus d'oeuvres se trouve le
"Carrousel de Monseigneur le Dauphin" de 1686. Or il se trouve que la BNF de l'Arsenal possède le livre de fête qui était distribué au public venu assister à cet événement et qui permet de savoir ce qui était joué et en quelle occasion.
 |
| s. a. (1686). Carrousel de Monseigneur le Dauphin. Paris : Chez la Veuve Blageart. |
 |
| s. a. (1686). Carrousel de Monseigneur le Dauphin. Paris : Chez la Veuve Blageart. |
Extraits choisis faisant mention des trompettes :
"Les Carrousels estant des Festes Militaires, & Galantes, des Jeux en forme de Combats, des Exercices guerriers changez en Divertissemens, leur Harmonie est ordinairement de deux sortes, l'une Militaire, fiere, & guerriere, l'autre douce & agreable; & l'une & l'autre se trouvent dans celuy-cy, puis que le bruit des Trompettes, & des Timbales y est mêlé à celuy des Hautbois. Quand les Instrumens, qui sont l'ame de ces sortes de Plaisirs, n'y seroient pas necessaires pour exprimer la joye qui doit estre inseparable de toutes les Festes, ils y devroient estre, parce que les Animaux aiment l'harmonie, particulierement celle des Trompettes & es Tambours qui les excitent au Combat, & aux Courses. Il ne faut pas s'étonner si ce qui touche les Animaux, est encore plus sensible aux hommes. Rien ne leur fait chercher la gloire avec plus d'ardeur dans les plus sanglans Combats. Celle des Prix d'une Feste pareille à celle-cy, n'est pas moins digne d'un coeur remply d'une belle ambition. On exposoit autrefois ces Prix publiquement, afin que ceux qui devoient combattre, fussent excitez à bien faire. Aprés les Courses, on reconduisoit les Victorieux dans leurs maisons au son des Trompettes, & l'Histoire nous marque que l'Empereur Andronic Paleologue les alloit luy-mesme conduire jusqu'à leur Logis, & que là le Victorieux, aprés avoir receu les applaudissemens de tout le monde, donnoit un verre de vin à chacun." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, pp. 20-22)
"Tous les Chevaliers, & les Dames s'habilleront en divers Apartemens du Chasteau, aussi-bien que leur suite, & quand l'heure de la Marche approchera, on verra dans la Place qui est entre le Chasteau, & les deux Ecuries du Roy, un Spectacle, qui bien qu'il ne fasse qu'une partie de celuy qui sera sur le point de paroistre, ne laissera pas de surprendre par sa beauté, & d'embarasser les Spectateurs, qui ne sçauront de quel costé tourner la veuë, parce que dans le mesme temps on verra sortir de la grande Ecurie les chevaux que les Chevaliers doivent monter pour le Carrousel, & de la petite Ecurie, ceux qui sont destinez pour les Dames. Ainsi la Marche sera double, & occupera en mesme temps toute la vaste Place qui est au devant de la premiere grille du Chasteau. Mr Dumont Major General des Quadrilles, accompagnera l'Equipage de Monseigneur, précedé de ses Trompettes, Timbaliers, & Hautbois, & suivy de ses Valets de pied." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, pp. 27-28)
"Les Estaffiers de Monseigneur le Dauphin seront habillez à la Grecque. Ils auront des Vestes d'étoffes rayées d'or & de bleu, & des Turbans bleus & argent, & le devant de leurs Vestes sera garny de boutonnieres noires, & or. Les Timbaliers, Trompettes & Hautbois seront vestus de mesme couleur, mais le dessein de leur habit est tout different de celuy des Estaffiers, & a quelque chose de plus particulier."("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 30)
"Tout cét équipage se rendra au pied de l'escalier le plus proche de l'Appartement de Monseigneur le Dauphin, où ce Prince montera à Cheval. Il viendra ensuite environné de douze Valets de pied, devancé de ses Timbaliers, Trompettes & Hautbois, dans la seconde Court, où ce Prince joindra Madame la Duchesse de Bourbon qu'il y trouvera environnée de ses Valets de pied." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, pp. 30-31)
 |
| Rigaud, H. (s. d.). Louis III de Bourbon, Prince de Condé. [huile sur toile] |
"Monsieur le Duc de Bourbon, & Mademoiselle de Bourbon, se rendront de leur costé dans la mesme Court, avec leurs Timbaliers, Trompettes, Hautbois, & tous leur Valets de pied." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 34)
"Les Valets de pied sont habillez en Persans. Le fonds de leur habit est incarnat avec des ornemens d'argent. Tout le bord de l'habit est noir, & or, leur Turban est à la Persanne. Les Timbaliers, Trompettes & Hautbois ont des habits de la mesme Nation, qui ne laissent pas d'avoir quelque chose de particulier dans leur maniere." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, pp. 35-36)
"Ouvre tous les habits dont je viens de parler, & ceux des Trompettes, Timbales, Hautbois, & des Valets de pied de Monseigneur, et de Madame de Bourbon ; de Monsieur de Bourbon, & de Mademoiselle de Bourbon. Il y aura encore six-vingt Estaffiers des Chevaliers, & des Dames, tous richement vêtus, & suivant ce que leurs Maistres, ou leur Maîtresses representent ; de sorte que cette grande diversité produira un agreable effet." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 51)
"Mr Dumont Major General des Quadrilles qui sera à la teste de cette Cavalcade, prendra (en remontant) son tour le long du bord de la Court de marbre, comme s'il vouloit aller à l'endroit opposé à celuy où ces deux Quadrilles seront en bataille : Cependant il ne fera que la moitié du chemin qui seroit necessaire pour s'y rendre, & lors qu'il se trouvera dans le milieu de cet espace, il tournera pour poursuivre sa route, & descendre par le milieu de la Court, vis à vis des portes des deux grilles. Ensuite paroistront, Le Trimbalier et les deux Trompettes de Mr le Duc de Saint Aignan." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 53)
 |
| Subleyras, P. H. (18e siècle). Le duc de Saint-Aignan donnant à Rome au prince Vaini le cordon de l'ordre du Saint-Esprit. [huile sur toile] |
"SECONDE QUADRILLE. Les Timbaliers & Trompettes de Monsieur le Duc de Bourbon. Ses Hautbois. Huit Valets de pied de Monsieur le Duc de Bourbon, & huit de Mademoiselle de Bourbon, marchand de la mesme maniere que ceux de Monseigneur le Dauphin, & de Madame de Bourbon" ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 56)
"On marchera en cét ordre jusques dans la Court de la grande Ecurie, où le Roy sera dans l'Appartement de Mr le Comte d'Armagnac qui est dans l'aisle qu'on trouve à main droite en entrant dans cette Court. Les deux Quadrilles feront le tour des Barrieres au bruit de tous les Instrumens qui les accompagneront, & d'un tres-grand nombre d'autres dont la carriere sera bordée. Les Airs qu'ils joüront ont esté faits exprés pour cette Feste, & sont de la composition de Mr de Lully. On doit remarquer que les Quadrilles tourneront à gauche en entrant, & poursuivront ainsi le tour qu'elles doivent faire le long des barrieres, afin que lors qu'elles passeront sous les fenêtres du Roy, les Dames se trouvent du costé de Sa Majesté. Ce tour estant achevé, tous les Timbaliers, Trompetes, & Hautbois qui auront servy dans la Marche se détacheront & se posteront aux quatre angles de la Carriere, où pour commencer la Comparse, les Quadrilles entreront par l'angle que l'on trouve sur la droite en entrant dans l'Ecurie, & qui se trouve du costé du Roy, & à la gauche de Sa Majesté, Monseigneur ayant fait le demy tour de la carriere prendra le milieu, & se mettra en bataille devant le Roy [...]" ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, pp. 59-60)
 |
| Mignard, N. (17e siècle). Portrait de Jean-Baptiste Lully (1632-1687). [huile sur toile] |
"Lors qu'ils auront demeuré quelque temps en cét estat, au bruit du grand nombre d'instrumens dont on a déja parlé, on fera un mouvement assez digne d'être remarqué." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 61)
"Les Trompettes suivant ce qui se pratique toûjours dans ces sortes de Spectacles, feront l'Apel aux quatre coins de la Lice, pour donner lieu aux Chevaliers de partir ensemble, & de fournir leurs Courses avec plus d'égalité, & l'on fera des Fanfares à l'ordinaire pour ceux qui auront fait leur quatre Testes, ce qui ne donne pas seulement lieu de faire éclater les applaudissemens qui sont dûs à l'adresse des Chevaliers ; mais ce qui la fait aussi sçavoir à ceux qui n'en peuvent estre entierement témoins, estant ou trop éloignez, ou placez trop peu avantageusement pour voir tout ce qui se passe dans la Lice." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 67-68)
"le tour achevé on sortira par la grande porte par laquelle on sera entré dans le mesme ordre, excepté que Mr le Duc de S. Aignan avec ses Trompettes & Timbales, se trouvera à la queuë en sortant de la Carriere, au lieu qu'il aura esté à la teste en y entrant." ("Carrousel de Monseigneur le Dauphin", 1686, p. 70)